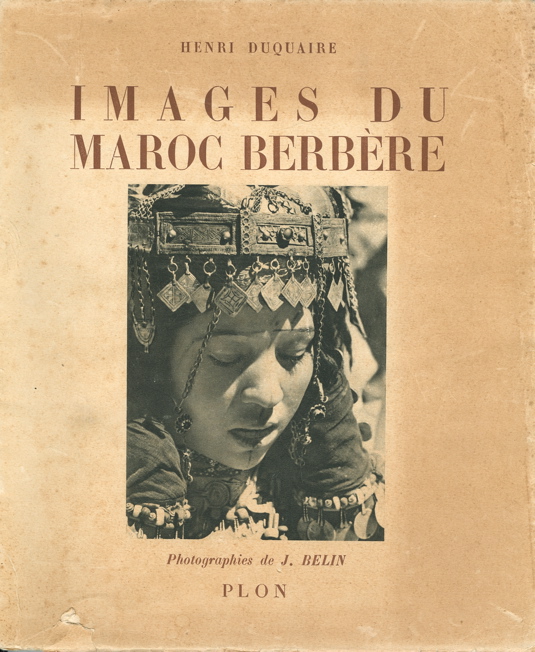Les Kasbahs
L'ahouach
Mis à jour : lundi 4 avril 2016 15:16L'ahouach ou ahwach ou ahwash désigne une musique et une forme de danse collective binaire, pratiquée dans les villages berbères du Haut-Atlas et de l’Anti-Atlas. Pour les autochtones où se déroule cette danse, lee chant dialogué qui l’accompagne est la partie la plus appréciée et aussi la plus difficile à réussir.
Lors des mariages et autres célébrations lors de fêtes qui portent le même nom, l'ahouach est interprété au son de la flûte avec accompagnement de bendir. Cette musique traditionnelle, est présenté sous forme d’animations où alternent spectacle haut en couleur et échanges entre les musiciens.
 La partie dansée, que l’on appelle derst, suit la dernière phrase de l'improvisation qui s’est peu à peu accélérée au rythme du tambour. Un raïs percussionniste, un premier danseur (a’allâm) et le musicien joueur de flûte métallique (tal’uwât ou awwasa) en sont les intervenants majeurs. Le musicien gère le rythme et débute son improvisation, le poète lance les premiers vers et les répète jusqu'à ce que le chœur les assimile. Puis, quelques battements de percussion entament le cycle avec un mouvement de plus en plus accéléré.
La partie dansée, que l’on appelle derst, suit la dernière phrase de l'improvisation qui s’est peu à peu accélérée au rythme du tambour. Un raïs percussionniste, un premier danseur (a’allâm) et le musicien joueur de flûte métallique (tal’uwât ou awwasa) en sont les intervenants majeurs. Le musicien gère le rythme et débute son improvisation, le poète lance les premiers vers et les répète jusqu'à ce que le chœur les assimile. Puis, quelques battements de percussion entament le cycle avec un mouvement de plus en plus accéléré.
L’aouach est également appréciée lors des cérémonies nocturnes dans laquelle les femmes forment
 une ronde autour d'un feu de branches légères. Au centre une douzaine d'hommes dans un cercle plus restreint sont tous munis de bendir. Le thème musical s'établit par soubresauts puis succèdent alors les bendirs sur lesquels la ronde des femmes commence à onduler. La danse arrive alors à son paroxysme lorsque la ronde des femmes se divise en deux groupes qui se font face et se donnent la réplique.
une ronde autour d'un feu de branches légères. Au centre une douzaine d'hommes dans un cercle plus restreint sont tous munis de bendir. Le thème musical s'établit par soubresauts puis succèdent alors les bendirs sur lesquels la ronde des femmes commence à onduler. La danse arrive alors à son paroxysme lorsque la ronde des femmes se divise en deux groupes qui se font face et se donnent la réplique. Chaque région a son propre style d'ahouach qui peut être mixte ou non, avec ou sans chant. Lorsque les deux sexes son représentés, le groupe des femmes est en face ou autour des hommes. Malgré l’impression de solennité qui se dégage de ces rencontres, l'ahwach reste une musique profane et l’occasion d’un rassemblement populaire, l’intérêt de l'évènement dépendant en grande partie de la subtilité et du talent des jouteurs et des danseurs.
Ahouach à la Kasbah du Glaoui à Taourirt
Source : Jean Ravennes. Aux portes du Sud - le Maroc. Ed. Alexis RedierVoyage effectué en 1929
C’est à Taourirt de l’Ouarzazate, en effet, qu’on rencontre le premier de ces châteaux du désert, dont les massifs polyèdres dépassent trente mètres de haut, avec des tours et des créneaux en pain de sucre, sans jours, mais décorés de frises qui rappellent la flore et la faune stylisées de l’ancienne Egypte. Une cour domestique et guerrière, dans ces palais d’Antinéa, vit des peuplades asservies; un caïd y cache ses somptueux délassements et n’en sort que pour de redoutables randonnées de police, quand il a besoin d’argent.
Lui seul a le pouvoir d’animer le désert, ce soir, sous l’énorme lune qui l’éclaire comme en plein jour. Un ronronnement s’élève, une lueur énorme sort du gouffre de murailles. Allons jusque-là, car sur une terrasse de la place d’armes intérieure, Si Hammadi, maître de l’Ouarzazate, nous a réservé la place des hôtes; le thé est servi par ses eunuques noirs dans une splendide vaisselle.
Des fellahs alimentent sans cesse, en bas, des feux de palmes dont les reflets lèchent les gigantesques parois rouges de la demeure; autour des foyers, sept à huit cents femmes (1) sont rangées, fabuleuse vision d’atours criards dans la nuit, foulards pourpres à franges, longues robes bariolées et comprimées par des ceintures d’or. Elles chantent et danses; le dialogue des voix, tantôt stridentes, tantôt enrauquées comme les sourdes clameurs dans les dunes, suit le rythme obsédant des musiciens accroupis sur de grands tambours au son grave; et leur danse n’est qu’un dandinement des hanches, invariable et sensuel.
Peu à peu cette cadence vous pénètre, vous trouble; on se balance aussi sans s’en apercevoir; l’irréalité fantasmagorique du spectacle y aidant, les yeux se ferment; on vacille, vaincu par une inexplicable ivresse qui alourdit la tête, il faut fuir, fuir au plus vite avec effroi la tentation mystérieuse. Jusqu’au jour, l’ahouach du feu continuera, dans une sorte de délire, les chants s’accentuant, le tortillement exprimant avec une violence croissant l’appel à la volupté, cependant que, derrière les grilles de la seule fenêtre percée tout en haut de la muraille, les femmes du harem, en grappes, lanceront leurs youyous comme des cris de mort.
Antinéa, Antinéa toujours ! Courte folie d’une nuit pour ces misérables serfs du pays de la famine et de la soif.
(1) Il y a probablement une erreur, la cour de la kasbah ne peut pas tenir autant de personnes.

Janvier 1943. Ahouach de jour pour la visite d'officiers américains.
Archives Decordier
Source : Henry Bordeaux. La revenante. Plon 1932, roman
Voyage effectué à l'automne 1930
... Elle a bien remarqué, en pénétrant de nuit dans l’immense kasbah du Glaoui dont elle a mal distingué les énormes façades et les tours crénelées perdues dans le ciel nocturne, les appareils d’un feu dans la vaste cour intérieure. Des nègres entassaient des palmes séchées.
Unies en une immense ronde, une farandole presque immobilisée, les femmes du ksar sont là, innombrables, parées de leurs plus beaux atours. Elles portent uniformément une tunique de gaze transparente sur le fond des robes blanches, crème, roses, orangées, bleu pâle, la tête enroulée dans un foulard multicolore en forme de diadème et rehaussé par une couronne dorée ou par un bijou, les nattes des cheveux tressées et enroulées de laines colorées. Cette ronde occupe le tour entier du patio. Au centre, le feu de palmes sans cesse renouvelées jette un éclat vif dans la nuit sombre.
Les noirs paresseux ont-ils négligé d’apporter du combustible ? Le feu mourant laisse courir les ombres sur les danseuses et sur les murailles. Puis il renaît, crépite, lance des étincelles pareilles à une nuée d’abeilles d’or, précise le spectacle, les visages, les gestes, dénonce subitement, sur les terrasses supérieures, celles des tours, la présence de formes blanches, de femmes voilées - les femmes du caïd - désireuses d’assister au ballet. Ainsi les façades de la kasbah passent-elles de la lumière à la demi-obscurité pour revenir à la lumière qui les détache en masses blanches.
Autour du feu se sont rangés, couchés ou assis par terre, de petits groupes d’enfants dont les yeux brillent de plaisir, la plupart négrillons; et l’un ou l’autre porte sur le dos, bien empaqueté, un petit frère ou une petite sœur qu’il secoue sans vergogne, comme si le fardeau faisait partie de lui-même. L’orchestre occupe, auprès du foyer, la place principale. Les jambes repliées sous eux, les musiciens chauffent de temps à autre leurs tambourins à la flamme ou agitent frénétiquement les objets de cuivre sur quoi ils frappent à tour de bras. La cadence régulière, à quatre temps, puis à trois temps, finit par atteindre les nerfs avec sa monotonie. Parfois les tambourins claquent comme des fouets ou éclatent comme des coups de fusil.
Mais voici que, pour renforcer l’orchestre, la ronde des femmes s’est divisée en deux demi-cercles qui, tour à tour, chantent des versets. Les cœurs alternent, se répondent, reprennent le même thème, ou le modifient en le transposant sur un ton plus bas ou plus aigu. L’une ou l’autre des choristes, surexcitée ou se sentant capable d’un solo, pousse parfois une série de cris stridents qui rompent la mélancolie du refrain et qui peuvent signifier aussi bien la lassitude de vivre que la puissance du désir. Cependant, coude à coud, hanche à hanche, sans se tenir autrement les unes aux autres que par cet appel des corps rapprochés, les danseuses ne cessent pas de tourner lentement, très lentement, en se balançant en avant et en arrière, par un mouvement rythmé correspondant à la musique, et en frappant leurs mains en cadence. La plupart d’entre elles sont noires. leurs mains levées sur le fond des robes claires, font des tâches d’ombre. Quelques Berbères, bronzées ou même presque blanches, par contraste, se dessinent en clarté parmi leurs compagnes. Quand les nègres alimentent le brasier avec une brassée de palmes nouvelles, tous ces visages s’illuminent, et le groupe de la terrasse peut distinguer leur expression tendue, extatique, leurs yeux dévorants, l’offre de tous de tous ces corps lancés et retenus tour à tour. Puis, comme dans un ballet, deux étoiles se détachent de la troupe dont la ronde se reforme immédiatement derrière elles. Accentuant un peu le mouvement, elles pointent du genou en avant comme pour une génuflexion et avancent ainsi un peu plus vite, mieux éclairées par le voisinage du feu, la tête redressée, presque renversée en arrière, le port fier, comme si elles avaient conscience de remplir un rôle plus important, et après avoir accompli leur tour intérieur, reprennent leur place pour être , un peu plus tard, remplacées par d’autres.
... Au centre de la ronde, un immense nègre, drapé dans une jaune djellaba, coiffé d’un haut turban blanc, d’une main tenant un bâton de commandement et de l’autre une lanterne à acétylène, ordonnateur de la cérémonie, anime tour à tour l’orchestre et les danseuses et communique sa puissance de vivre à tous les officiants comme s’il était le centre du monde et que son pouvoir s’étendait jusqu’aux étoiles.
 Henri Bordeaux. Extrait de : Un printemps au Maroc. Plon 1931
Henri Bordeaux. Extrait de : Un printemps au Maroc. Plon 1931
Taourirt, le 20 mars 1931
Le souvenir de la diffa qui nous fut offerte par le khalifa du Glaoui est effacée par celui de la danse berbère qu’on appel l’ahouach.
Quant notre automobile, les phares allumés, franchit la grande porte de la kasbah pour nous conduire à l’invitation du khalifa, nous fûmes accueillis dans la cour intérieure, le patio, par une scène des Mille et une Nuits.
Des cris d’épouvante furent poussés par une multitude de femmes en robe claire et, dès que la voiture s’arrêta, rassurées, elles reformèrent le cercle autour d’un grand feu. Ce feu dont les hautes flammes montaient dans la nuit commençante, éclairant les façades des bâtiments et des tours, était entretenu par les palmes séchées qu’une corvée de nègres apportait sans cesse. D’autres noirs le surveillaient et soulevaient les palmes quand elles risquaient de l’étouffer.
Unies en une immense ronde, une farandole presque immobilisée, les femmes du ksar étaient là, parées de leurs plus beaux atours. Elles portaient uniformément une tunique de gaze transparente sur le fond des robes blanches, crème, roses, orangées, bleu pâle, la tête enroulée dans un foulard multicolore en forme de diadème et rehaussé par une couronne dorée ou par un bijou, les nattes des cheveux tressées et enroulées de laines colorées.
Nous ne fîmes que traverser leur cercle pour gagner les appartements où, sur les tapis et les coussins, nous étions conviés à la diffa. Mais, au sortir du banquet, nous montâmes sur la terrasse, et c’est de là que nous assistâmes à la fête berbère.
Le cercle s’était élargi, la ronde s’était agrandie par l’arrivée de nouvelles recrues. Elle occupait maintenant le tour entier du patio. Au centre, les palmes renouvelées jetaient un éclat plus vif dans la nuit devenue plus sombre; mais, quand nous levions la tête, le ciel apparaissait piqué d’étoiles qui, par la pureté de l’air, semblaient, comme en montagne, s’être rapprochées. Parfois les noirs, paresseux, négligeaient d’apporter du combustible, et le feu mourant laissait courir les ombres sur les danseuses et sur les murailles. Puis, il renaissait, crépitait, lançait des étincelles pareilles à une nuée d’abeilles d’or, précisait le spectacle, les visages, les gestes, dénonçait subitement, sur les terrasses supérieures, celles des tours, la présence de formes blanches, de femmes voilées - les femmes du khalifa - désireuses d’assister à la scène. Ainsi les façades de la kasbah passaient-elles de la lumière à la demi-obscurité pour revenir à la lumière qui les détachait en masses blanches.
Autour du feu s’étaient rangés, couchés ou assis par terre, de petits groupes d’enfants dont les yeux brillaient de plaisir, la plupart négrillons, et l’un ou l’autre portait sur le dos, bien empaqueté, un petit frère ou une petite sœur qu’il secouait sans vergogne, comme si le fardeau faisait partie de lui-même. Un groupe de femmes s’était formé un peu plus loin, bonnes vieilles exclues de la danse et, parmi elles, deux dominos blancs, femmes de notables qui n’avaient pu résister à leur curiosité.
L’orchestre occupait, auprès du foyer, la place principale. Les jambes repliées sous eux, les musiciens chauffaient de temps à autre leurs tambourins à la flamme ou agitaient frénétiquement les objets de cuivre sur quoi ils frappaient à tour de bras. La cadence régulière, à quatre temps, puis à trois temps, finissait par atteindre les nerfs par sa monotonie. Parfois les tambourins claquaient comme des fouets ou éclataient comme des coups de fusil. Le rythme de ces instruments barbares n’était pas sans beauté, ni sans mystère. On se surprenait à y entendre battre le cœur de l’Afrique sensuelle, fétichiste, mêlée aux choses, écrasée de soleil. On y découvrait cette sorte de nostalgie que seule exprime la musique, nostalgie d’un bonheur qu’on ne perçoit pas nettement, qu’on pressent impossible à réaliser par les seules forces humaines, pour lequel il faudrait une pitié du destin, une douceur de Dieu. Pauvres tam-tams sans grâce et pourtant presque douloureux et émouvants !
Mais l’orchestre n’était pas abandonné à lui-même. La ronde des femmes était divisée en deux demi-cercles qui, tour à tour, chantaient des versets. Les chœurs alternaient, se répondaient, reprenaient le même thème, ou le modifiaient en le transposant sur un ton plus bas ou plus aigu. L’une ou l’autre des choristes, surexcitée ou se sentant capable d’un solo, poussait parfois une série de cris stridents qui rompaient la mélancolie du refrain et qui pouvait signifier, aussi bien la lassitude de vivre que la violence du désir. Cependant, coude à coude, hanche à hanche, sans se tenir autrement les unes aux autres que par cet appel des corps rapprochés, les danseuses ne cessaient pas de tourner lentement, très lentement, en se balançant en avant et en arrière, par un mouvement rythmé correspondant à la musique, et en frappant leurs mains en cadence. La plupart d’entre elles étaient noires. Leurs mains levées sur le fond des robes claires, faisaient des taches d’ombre. Quelques Berbères, bronzées ou même presque blanches, par contraste, se dessinaient en clarté parmi leurs compagnes. Quand les nègres alimentaient le brasier avec une brassée de nouvelles palmes, tous ces visages s’illuminaient, et nous pouvions distinguer leur expression tendue, extatique, leurs yeux dévorants, l’offre de tous ces corps lancés et retenus tour à tour. Puis deux étoiles se détachaient de la troupe dont la ronde se reformait immédiatement derrière elles. Accentuant un peu le mouvement, elles pointaient du genou en avant comme pour une génuflexion et avançaient ainsi un peu plus vite, mieux éclairées par le voisinage du feu, la tête redressée, presque renversée en arrière, le port fier, comme si elles avaient conscience de remplir un rôle plus important, et après avoir accompli leur tour intérieur, reprenaient leur place pour être, un peu plus tard, remplacées par deux autres.
Comment oublier, au centre de la ronde, l’immense nègre, drapé djellaba jaune, coiffé d’un haut turban blanc, d’une main tenant un bâton de commandement, et de l’autre une lanterne à acétylène, qui fut l’ordonnateur de la cérémonie, animant tour à tour l’orchestre et les danseuses, communiquant sa puissance de vivre à tous les officiants et suivi, travesti, contrefait par un bouffon noir esquissant des entrechats ?
De loin, de la terrasse que nous occupions, cette danse grave, solennelle, presque sacrée, fut vraiment un très beau spectacle. Plus tard, quand nous dûmes pour repartir franchir à nouveau le cercle des danseuses, les détails rapetissant nous apparurent avec les traits difformes, les accusations de l’âge, cette ingratitude des visages noirs dont je ne sais pas distinguer l’attrait. Pourquoi sommes-nous descendus des terrasses ? Que du moins notre impression de la beauté de l’ensemble soit sauvegardée ! Et même, à y réfléchir, fut-elle vraiment atteinte parce que, de près, la disgrâce des danseuses devint visible ? Il leur restait l’essentiel, l’extase où elles étaient plongées, l’élan qui les soulevait et qui devait les soulever pendant des heures, car la fête avait commencé avant notre venue et devait durer toute la nuit. J’ai aspiré tout un soir ce mélange de volupté barbare et de prière mystique qui donna son accent à cette danse autour du feu.
Dans l’automobile découverte qui nous ramenait à notre gîte d’étapes, le Taourirt français de l’Ouarzazate, je me suis retourné pour revoir encore, dans la nuit, les hautes murailles crénelées de la kasbah éclairées par les lueurs mouvantes du brasier, pour écouter les tambourins et les cris aigus des femmes qui se répondront jusqu’à l’aube...
Henry Bordeaux. Extrait de : Le miracle du Maroc. Plon 1934, roman
29 mars 1934. Ahouach, troisième version
Le caïd, qui est le frère aîné du Glaoui, pacha de Marrakech, nous offre ce soie le plus beau spectacle qui ne puisse offrir à des étrangers : cette danse berbère qui s’appelle l’ahouach et qui s’exécute en ronde autour d’une grand feu.
Nous nous rendons en cortège à la kasbah. Le vent est si fort qu’il a fallu renoncer à la cour d’honneur et se contenter d’une autre cour plus petite, mais mieux abritée et de forme triangulaire un peu gênante pour le développement de la ronde. De la terrasse où le caïd nous a fait monter, je me penche sur les musiciens. L’orchestre est composé de tambourins que les tambourinaires chauffent à la flamme du foyer afin qu’ils claquent mieux au choc des mains. Un nègre scande le rythme sur la grosse caisse qu’il frappe de son battant avec une vigueur inouïe. Cette caisse est un ancien fût d’essence aménagé. Un immense noir dirige les instruments qu’accompagne une cantilène de voix monotones. Parfois le rythme se précipite, devient impérieux et enlevé. Il s’en dégage une sorte de tristesse violente, toute physique, toute matérielle, mais qui n’est pas sans poésie - la poésie de l’Orient, lourde, accablée, voluptueuse sans charme et sans tendresse.
Au centre de la cour, le bûcher jette ses hautes flammes claires , sans cesse alimenté par les palmes sèches qu’apportent les serviteurs, j’allais dire les esclaves, mais n’est-ce point pareil au Maroc ? Un nègre, aussi démesuré que le chef d’orchestre, règle le feu, qui tantôt s’assourdit en fumée, et tantôt jaillit fulgurant et splendide, léchant les murailles immenses, éclairant les moindres recoins, montant jusqu’à la plus haute tour où il découvre, aux fenêtres grillées, les femmes du caïd qui, voilées, ont voulu assister au spectacle.
Le spectacle, une ronde allongée à cause de la cour triangulaire, d’une centaine de femmes vêtues de leurs plus belles robes de fête, soie blanche, orangée, feu, rose ou bleue que recouvre une tunique de gaze transparente, parées de tous leurs lourds bijoux d’argent autour du cou, des poignets, des chevilles, au bout des oreilles, et couronnées de foulards multicolores qui leur servent de diadèmes. Elles se serrent les unes contre les autres, frappent avec un grand bruit leurs mains brunies de henné et qui, de haut, semblent des mains de négresses, chantent d’une voix gutturale une mélopée monotone, qui se mêle au bruit assourdissant des tambourins, et exécutent une sorte de danse hiératique par un fléchissement en avant et un redressement en arrière. parfois deux étoiles, qui doivent revendiquer leur rang avec obstination, comme les vieilles actrices de paris qui ne veulent point céder leur rôle de jeunes premières, éternellement jeunes, à des rivales plus fraîches, sortent de la ronde, se jettent en avant, accentuant les génuflexions et les relèvements avec une dignité d’automate. Que ne sont-elles remplacées par celle-ci là-bas, ou celle-là plus rapprochée que le brasier caresse de ses lueurs rouges, laissant voir un joli visage berbère presque enfantin, rieur et gracieux.
Sur les terrasses qui bordent la cour, des femmes drapées de voiles blancs sont assises en groupe. Elles se doublent en ombres noires au reflet du feu, comme si elles étaient accompagnées de leurs propres fantômes. Se chauffant et regardant, une grappe d’enfants est à demi couchée près des palmes qui alimentent le foyer.
Et les tambourins claquent comme des fouets ou éclatent comme des coups de fusil. Le rythme de ces instruments barbares n’est pas sans beauté, ni sans mystère. On se surprend à y entendre battre le cœur de l’Afrique sensuelle, fétichiste, mêlée aux choses, écrasées de soleil. On y découvre cette sorte de nostalgie que seule exprime la musique. pauvres tams-tams sans grâce, et pourtant presque douloureux et émouvants !
Nous revenons au poste des Affaires Indigènes, tandis que l’étrange concert de la monotone danse nous poursuivent de leurs appels langoureux. La lune est miraculeusement belle. La lune, en croissance, pose ses clartés pâles sur la kasbah qui semble plus formidable encore et presque fantomatique, et s’en va miroiter, tout au fond de l’horizon, sur les neiges de l’Atlas comme une lampe à demi voilée sur des épaules de femme...
André Armandy. Extrait de : Hommes de roc, Forteresse d’argile. Librairie Alphonse Lemerre, Paris 1936
Voyage effectué probablement en mai 1934.
La kasbah de Si Hammadi s’élève sur les bords de l’oued, à deux kilomètres du poste. Pour répondre à l’invitation de l’ahouache nous y allâmes en auto. Ce fut un émerveillement. Sous la magie nocturne le pays avait changé d’âme. Le cône de clarté des phares, en parcourant la palmeraie, la transformait en forêt d’un autre âge où glissaient des ombres bibliques. Subitement, la clarté s’écrasa contre les murs d’un château de légende, glissa sur eux, les contourna, et s’arrêta devant un vaste porche dont l’arche noire s’ouvrait sur une vision démoniaque.
Qu’on s’imagine une grande cour intérieure, profonde, entourée de remparts et dominée de terrasses étagées. Comme fond de décor, une haute bâtisse, massive, féodale, flanquée de grosses tours carrées, percée d’étroites meurtrières jusqu’aux deux tiers de sa hauteur, puis, dans les hauts, de petites fenêtres grillées, dont quelques-unes en saillie et garnies de moucharabieh.
A l’exception d’une unique terrasse, les autres n’ont point d’escalier. On y accède par de hautes échelles de bois noueux, dont les degrés semblent taillés à la mesure d’un géant. Des ombres y sont accroupies, parmi lesquelles surgissent d’autres ombres, le poing coiffé de feux follets.
Au centre de la cour, un énorme brasier, qu’entretient un grand diable en y jetant des palmes par brassées, lance à travers l’espace une prodigieuse jonglerie de flammes et d’étincelles. Et autour de ce feu d’enfer, le cernant largement de leur anneau gesticulant, des houris font face aux démons au milieu d’une cohue d’ombres.
Les femmes, de taille si pareille qu’on les dirait calibrées, sont uniformément vêtues de blanc et coiffées de foulards orange. Elles ont le visage nu, les lèvres violemment fardées, les paupières bleuies de kohl. Toutes portent sur le menton le tatouage rituel en point d’exclamation. Elles sont rangées en demi-cercle, côte à côte, hanche contre hanche, épaule contre épaule, et si étroitement appuyées l’une à l’autre qu’on les dirait soudées comme les maillons d’un collier. Le feu, en les éclairant violemment, les fait exactement semblables, et n’en laisse plus subsister qu’une mouvante symétrie de formes, de gestes et de couleurs.
Elles chantent, et leurs bouches trop rouges font éclore d’un coup une rangée de fleurs pourprées sur leurs visages trop poudrés. Elles scandent leur chant d’un battement de mains, et toutes ces mains brunes dessinent rythmiquement sur la blancheur des robes le même geste triangulaire qui les accole, les soulève, puis les disjoint. Elles ne dansent point, mais marquent la mesure d’un fléchissement des jarrets, et le même sursaut de croupe secoue leur mouvante guirlande sans en rompre l’alignement.
Du côté opposé, fermant l’anneau, un demi-cercle sombre fait face au demi-cercle clair. Trente ombres accroupies, qui se silhouettent à contre-clarté sur le feu, cinglent de leurs doigts bruns la peau de larges tambourins. Et tandis que le démon du feu nourrit de charretées de palmes le brasier pétillant, debout parmi les noirs tambourinaires, un autre possédé, plus farouche, plus frénétique, scande le rythme à grands coups de courbache sur une peau tendue sur un gigantesque tonneau.
Essayer d’analyser cette cadence bizarre qui happe les nerfs, c’est inanalysable. Les mains des femmes ne frappent point en même temps que les tambourinaires, et le prodigieux timbalier a son rythme particulier. Nul synchronisme dans leur jeu. Tous procèdent à contretemps. Et cependant, ces rythmes différents, heurtés, cacophoniques, se rejoignent invariablement à point nommé dans cette démoniaque symphonie.
Le feu des palmes lance des gerbes surprenantes qui se dissolvent, meurent et soudain renaissent très haut d’une vie éphémère. Une fumée légère à relent de santal flotte sur le tableau. Le reflet du brasier, en escaladant les terrasses, s’empare de ceux qui les couronnent et les projettent en ombres fantastiques sur les murs rouges de la grande kasbah. Et tout cela compose un spectacle grandiose, qui ne doit rien à l’art, qui doit tout à l’instinct; une vision hallucinante qui laisse dans l’esprit un souvenir impérissable.
Marcel Homet. Extrait de : Méditerranée, mer impériale. Edition NRC 1937
Voyage effectué en décembre 1936
Enfin Ouarzazate, poste du désert, gardien du Sud, dominant de son bordj imposant les maigres sinuosités de l’oued Ouarzazate dont le confluent avec le Dadès formera un peu plus au sud, le fameux oued Drâa aux somptueuses oasis.
La région est à peine pacifiée. On ne circule qu’en “sécurité”, c’est-à-dire que des troupes sont déplacées pour assurer la sécurité des voyageurs. Ceux-ci sont encore rares, car les hôtels (en construction) sont presque inexistants.
Ce pays du Sud a pour moi un autre charme que celui du tourisme. Passé l’Atlas tout vain bruit s’éteint ! Ici la “politique” n’a pas de place. Sur le Drâa, dans l'Ouarzazate, sur les confins on travaille, on peine, on souffre et l’on pense encore aux morts dont les derniers sacrifices datent d’à peine quelques mois.
... Depuis que je suis entré je me frotte vigoureusement les yeux pour me convaincre que je ne rêve pas. Je suis dans la kasbah de Taourirt d’Ouarzazate, l’une des plus belles du sud marocain. Elle appartient au Glaoui dont le très vieux frère, qui a atteint l’âge respectable de quatre-vingt-cinq ans, vient de me faire les honneurs.
C’est l’ahouach, l’antique danse du feu, que nous allons voir ce soir et qui se célèbre dans la cour la plus profonde du burg le plus imposant.
Devant la porte, vingt porteurs de torches, après s’être inclinés devant le colonel Chardon et moi-même, nous ont encadrés pour nous conduire à l’intérieur de l’édifice.
Dans la dernière cour, le khalifa nous attendait, digne dans les plis immaculés de son burnous traînant par terre. Ce furent alors les salutations d’usage : alternances en arabe de demandes et de réponses qui s’énoncent gravement, la main sur le cœur, et qui s’achèvent, en se baisant les doigts, par un murmure double : Amdoullah (Que Dieu soit loué !)
Alors le khalifa Si Hammadi, ce vieillard dont de Foucauld parle dans sont impérissable “Reconnaissance au Maroc”, nous précède jusqu’à des chaises qu’il a fait préparer, la sienne restant modestement quelques mètres en arrière.
Le spectacle est prenant ! Au milieu de la cour est un brasier qu’un gamin attentif alimente constamment. Près de lui une quinzaine d’hommes, assis, ont entre leurs genoux divers instruments de musique, dont ils jouent en sourdine : tam-tam, tambourins, violons monocorde, tandis que le chef d’orchestre, muni d’une énorme maillet, indique la cadence en tapant à tour de bras sur un tonneau fermé d’une peau de mouton.
Les hommes chantent à mi-voix, lentement, une sorte de cantique, mélopée traînante qui va chercher jusqu’au fond des âges révolus la prière de l’humanité reconnaissante envers l’élément sacré qui lui permet de vivre.
De l’autre côté du feu sont cinquante jeunes femmes dévoilées, car les Berbères ne se voilent pas. Elles sont alignées sur un rang. Toutes sont vêtues de longues robes de mousseline brodées masquant, comme le veut le Coran, les grâces de leur corps. Sur leur tête des voiles de soie jaune sont serrés, tandis qu’à leurs oreilles, sur leur front, le long de leur cou descendent en longs colliers des dizaines de pièces de monnaies qui vont rejoindre les bracelets couvrant leurs bras.
Avec leur visage bronzé, tatoué de bleu sur le front, le nez et les pommettes, ces femmes ressortent curieusement sur la noirceur du mur devant lequel elles vont danser. Pour le moment elles ont une pose hiératique. Immobiles et droites dans leurs voiles immaculés, elles enlèvent leurs mains jointes teintes de rouge henné, à la hauteur de leur visage dans ce geste éternel de prière que toutes les religions ont emprunté aux vieilles humanités.
Lentement, au fur et à mesure que la musique accélère sa cadence, que le chant des hommes s’élève dans l’air calme, elles commencent à s’animer. Ce sont d’abord leurs pieds qui esquissent un léger pas de danse, puis les hanches qui se trémoussent, enfin tout le buste qui s’incline légèrement en avant, tandis que les mains battent à contretemps, suivent la mesure des tambourinaires.
Chaque période est soulignée d’un “La ! La ! La !” traînant. Jusqu’aux enfants qui, à l’intérieur du cercle, s’essaient à danser. Les plus petits amenés par leur mère viennent familièrement dans nos jambes et rien n’est plus touchant que ce spectacle de deux d’entre eux, l’un de six mois, l’autre de six ans, celui-ci apportant le premier près du feu.
Mais la musique accélère sa cadence. on voit le turban blanc du chef d’orchestre plonger avec frénésie au milieu du cercle des musiciens. Les coups sont plus rapides, plus violents, les voix des hommes se sont tues remplacées par celles des femmes qui s’agitent rapidement. C’est alors que successivement, deux danseuses rentrent dans le cercle. Elles sont jeunes, jolies, presque élégantes en dépit des longues robes qui les enveloppent étroitement. On sent néanmoins à leurs mouvements plus souples, plus prestes, qu’elles doivent avoir un corps gracile, prêt à l’amour qui précède toujours et jusqu’en nos civilisations dites raffinées, la danse voluptueuse des anciens. A petits pas pressés, elles viennent près de nous, se déhanchant, elles nous regardent fixement, puis d’un mouvement rapide, elles fuient à l’autre bout de la cour. Enfin, épuisées, elles s’abattent à côté du feu qui les enveloppe de sa chaude lumière.
Mais leurs compagnes ne se sont point arrêtées; au contraire, la danse est animée d’un mouvement si vif qu’on peut à peine le suivre. Brusquement, un coup de gong claque. Alors les femmes s’immobilisent et, dans un charmant mouvement de pudeur, mettent sur leur visage leurs mains jointes qui ne laissent plus voir que de grands yeux noirs cernés de kohl. Au bout d’un instant, le même rythme recommence. le feu, à nouveau entretenu, jette en l’air ses longues flammes rouges et jaunes qui vont à quarante mètres éclairer l’échauguette construite au-dessus de la porte. Bientôt de tous côtés, des feux de Bengale s’allument. Il y en a de verts, de rouges, de jaunes, qui éclairent d’un jour fantastique l’étroite et haute cour. Et l’ahouach se poursuit, reprenant sans se lasser les strophes de ses chants éternels.
Les tambourins recommencent à gémir sourdement, les hommes à chanter tandis que les femmes se balancent. Toujours à contretemps, les chants suraigus s’élèvent. Une fois de plus le rite millénaire prend jusqu’au fond d’eux-mêmes ses desservants emportés par leur foi mystique.
Un serviteur arrive porteur de thé traditionnel. Nous le buvons avec plaisir alors que, comme les hommes de jadis, nous nous serrons frileusement autour du feu. Il est temps de rentrer. Avec les Salam Aleikoum d’usage nous quittons Si Madani et gagnons nos logis.
 Michel Bataille.
Michel Bataille.
Extrait de : La marche au soleil. Ed. Robert Laffont, sans date ?
Le vent de poussière contraint à porter des lunettes de sable. Ville ingrate, une kasbah colossale aux très petites fenêtres trouant de gigantesques parois verticales couleur sang coagulé, a été construite en même temps que Versailles, nous dit-on.
Le soir même, au ksar, le khalifa donne une fête avec danse. La lumière des torches nous accueille. On pénètre par des passages étroits, longeant les écuries. On traverse la seconde cour, pleine de monde, éclairée de flambeaux, bordée de hauts murs montant jusqu’au cœur de la nuit. On nous conduit sur une terrasse, qui la domine comme un balcon.
Au milieu de la cour, un feu, où un enfant jette du bois. Plus loin, le groupe des musiciens. Derrière, le long de trois murs de la cour, la longue file verticale des femmes qui vont donner la danse. Tuniques blanches, écharpes, foulards, bijoux multicolores. Les visages nus, quelques-unes nègres, les autres chleuh. De bout côte à côte, elles font un mur de vie.
Des cris rythmés jaillissent; un chant rauque. Les têtes, la file ondulante des mains jointes scandent la musique. Le chant s’affermit, s’accélère.
Tout à coup, comme une armée se met en marche, tous les tambours attaquent à la fois. Le rythme se précipite à chaque moment davantage, les ombres dansent sur les murs rouges des tours, les couleurs du chant convulsent la nuit; une exaspération démente et, soudain, elle explose en silence.
L’enfant remet du bois au feu. Les silhouettes se décontractent. Les escaliers, les tours réapparaissent. Un lévrier vient près du feu, comme dans les tableaux de Delacroix. Là-bas, le khalifa, dédaigneux, regarde.
Une autre danse. Les tambours, tendus à la chaleur du feu, reprennent leur martèlement de fureur. Les paumes battent. La file des femmes, en cadence, se déplace très lentement, d’un pied sur l’autre. Une danseuse vient de tourner seule sur l’espace vide, dodelinant de la tête, absente comme un oiseau mort. Et ce chant, ce chant sauvage au rythme haché, s’accélère de nouveau ! Les musiciens se penchent sur leurs instruments, comme sur l’encolure d’un cheval au galop. On se lève malgré soi, porté par une ivresse violente. Le silence. Plus tard, une autre danse encore.
... Les danses semblables, immuablement cruelles, vont durer toute la nuit. Derrière les fenêtres étroites çà et là percées dans les murs, on aperçoit des visages de jeunes filles : les femmes du khalifa. L’une d’elles, à un moucharabieh, tient contre sa tempe le visage d’un bébé.
Enlevées par la force, de l’argent ou des armes, en raison de leurs différentes beautés, livrées aux caprices, aux jalousies d’un sot, sans autre consolation que les enfants que sa folie leur laissa, en qui elles caressent leur triste image, elles trouvent leur plaisir douloureux dans une danse une minute aperçue, malgré l’interdiction du harem.
Le khalifa, élégant, irréprochable, regarde la cour avec un maintien noble, imperceptiblement ennuyé. Cette souffrance derrière les murs l’importune. Elle grouille inutilement, n’accroît pas son plaisir.
Le maître de danse arrache avec brutalité du cercle une danseuse qui a fait un faux pas. Les autres, heureuses, continuent de chanter sur trois notes obsédantes, à jamais inlassables. Les ombres dansent sur les hauts murs rouges.
Un chien traverse le cercle. Trois serviteurs, portant haut l’appareil du thé, passent. L’enfant alimente le feu au rythme des tambours. Les danseuses piétinent avec une rage contente, sous la nuit révolue. Leurs mains brunes sculptent sur place le chant. Les musiciens aux tambours battent la charge, la guerre, battent le galop de la cavalerie, un galop de cavalerie irrégulière !
Derrière les fenêtres, le visage des jeunes filles mortes regarde en silence. Adieu !
Source : Barrère-Affre Marie : Balcon sur le désert. Ed. Bonne Presse 1950
Réception à la kasbah de Taourirt
A Ouarzazate, les sels minéraux abondent et donnent à la terre des teintes extraordinaires. Tantôt violet, tantôt blanchâtre, tantôt sépia ou ocré, parfois nettement jaune, le terroir des contrées d’Atlas est varié à l’infini mais, le plus souvent, l’argile pourpre domine.
La kasbah du caïd Hammadi est d’un brun chaud patiné de veines rougeâtres. Le soleil en la cuisant au cours de multiples étés lui a donné mille précieux reflets. Vaste, belle, excessivement curieuse, l’énorme forteresse surgit comme une fabuleuse vision.
Pour la pétrir, l’orner, la creuser de dessins géométriques et la hérisser de balcons fermés; pour en dresser les tours plus larges à la base qu’au faîte; pour damer les hautes terrasses plates par-dessus des charpentes de palmier, toute une tribu a travaillé sans répit pendant des années. Peu à peu les murs s’élevèrent, et les bastions épais, et ces étranges tours qui vont s’amincissant à mesure qu’elles montent, comme celle des palais de l’antique Assyrie. Et un jour l’énorme bâtisse achevée érigea en face de l’Atlas sa masse imposante et le soleil commença à la mordre comme on mord un fruit, à la patiner de lumière !...
Un naïb de Si el Hammadi attend les visiteurs à la porte. Celle-ci ouvre des battants gigantesques, doublés et cloutés de fer. L’intérieur de l’édifice offre un effarant dédale de cours surpeuplées, de couloirs obscurs et d’escaliers usés. Il faut traverser tout cela à la suite du guide. Enfin, au fond d’une sorte de fondouk populeux où bêtes et gens se confondent dans la fumée des brasiers du soir, la façade muette d’un lourd donjon avance ses contreforts de terre et sa porte énorme. L’arc de la voûte franchi, on trébuche dans les demi-ténèbres d’un sol inégal et humide. Des odeurs d’étable et de moisissure circulent dans un violent courant d’air, et des formes humaines courent çà et là : négrillons, esclaves, mokhaznis portant le poignard au côté, Chleuhs au visage fin et rusé sous la cordelette brune qui leut ceint les temps.
Si el Hammadi reçoit ses hôtes dans une salle ouverte au sommet d’une tour. Il faut, dans une pittoresque escalade, s’évader vers les hauteurs par un escalier fait de terre pétrie, cuit et recuit par des années de soleil. Chaque marche est bordée de troncs de palmiers non équarris, que le va-et-vient des pieds a usé sur le bord supérieur, mais qui par-dessous a encore des touffes de fibre desséchée. Un souffle rapide et chaud passe brusquement sur les visages : voici les terrasses brunes, les terrasses suspendues sur leurs armatures de palmiers morts et de lauriers-roses à jamais flétris.
Dans une chambre carrée, la somptuosité des grands tapis blancs et noirs, rebrodés de tous les plus chantants coloris, reçoit les convives. Le colonel, installé aux côtés du caïd, conserve amicalement avec lui et de nombreux officiers les entourent, parmi lesquels quelques dames font assaut d’élégance. Brun, fin, menu dans son burnous de laine blanche, Si el Hammadi se lève pour accueillir les arrivants. Ses prunelles sont singulièrement vives sous ses paupières tombantes, et son accueil s’imprègne d’une grande cordialité.
... On apporte plusieurs petites tables basses et rondes; des serviteurs noirs se succèdent, tenant à pleines mains les plats cachés sous leurs couvercles pointus. Une odeur de beurre, de viande et de légumes se répand dans la salle. Le caïd s’éclipse, la coutume interdisant au maître de la maison de s’attabler avec ses convives.
On distribue des serviettes aux Européens, par égard à leurs habitudes, et quand le couscous énorme et blond apparaît sur les tables, une négrillonne au teint d’ébène fait une distribution générale de cuillères d’argent. Le caïd réapparaît alors, s’inquiétant de savoir si ses hôtes ont suffisamment à manger. Dehors la nuit est tombée et depuis longtemps un vieux noir emperruqué de blanc a allumé de grosses lampes. Le thé est servi, d’une douceur qui masque un peu son âpreté légère, et la menthe y mêle son parfum puissant, évocateur de jardins lumineux. Puis les petits serviteurs qui courent pieds nus sur les tapis magnifiques font disparaître les verres filigranés d’or, et Si el Hammadi se levant invite ses hôtes à le suivre. De la terrasse voisine on passe dans une autre salle, rectangulaire cette fois, puis sur un vaste balcon couvert qui bée dans la nuit étoilée. Venez, approchez-vous du parapet : l’ahouach va commencer.
Cette singulière terrasse est greffée en saillie au flanc du donjon. En haut, l’auvent finit en une ligne nette, et au delà fulgure les astres sur la nocturne paix du ciel. En face s’estompent les autres bâtiments du ksar, tours et murailles, avec ça et là quelques petites lampes timides vrillant l’obscurité. Au pied, le vide stagne comme un puits sombre, et l’on y devine à peine des formes blanchâtres qui vont et viennent. Des rires étouffées, des chuchotement en montent, avec quelquefois une exclamation rauque et sauvage.
Soudain en bas, une flamme rouge jaillit, saluée par des exclamations. Quatre démons noirs, le torse nu, alimentent de branches un brasier dont s’échevèle une toison d’étincelles et qui brûle avec des salves de crépitement joyeux. Près de ce feu, des hommes accroupis attaquent brusquement une mélodie barbare, un chant rythmé, guttural, qu’ils scandent de tambourins cependant qu’une sorte de géant frappe à tour de bras une peau tendue sur des cercles de fer. Mais tout cela semble peu de choses sans l’extraordinaire vision qui complète le spectacle.
Entourant complètement les musiciens et le brasier flamboyant, un immense cercle de femmes vêtues de blanc forme une couronne mobile. Fardées, enrichies de bijoux qui luisent comme leurs prunelles et leurs dents, battant des mains, pliant leurs jarrets avec une ensemble impressionnant, les filles d’Ouarzazate dansent l’ahouach, la vielle danse traditionnelle inspirée de quelque mythe ancien, et dont les mouvements monotones ont quelque chose de rituel...
Un chœur de voix rauques a éclaté, répétant, répétant sans cesse le même motif sauvage, et trépignantes, accélérant leurs claquements de paumes et leurs demi-génuflexions, les ksouriennes avancent et reculent, élargissant leur cercle et le resserrent, tandis que sur leurs robes blanches la flamme de plus en plus haute lance des coulées pourpres et des palpitations dorées.
Personne ne saurait dire les origines ni la signification de cette danse. Eut-elle jadis pour but d’apaiser l’ire de quelque djinn malfaisant ? Célébra-t-elle des victoires, et fut-elle dansée dans des soirs de batailles par de sauvages filles dont les robes étaient rouges, non du reflet des flammes, mais du sang ennemi ? Sans doute !... Ce spectacle maintenant n’est plus qu’une manifestation de joie offerte en hommage aux visiteurs du caïd, un banal simulacre de l’ardente ronde où s’exaltait autrefois l’âme primitive des Chleuhs !...
Les invités considèrent avidement le jeu inouï de coloris et de lumières, secoués par le chœur dont les versets se répondent avec une sorte de furie. Tous se taisent, empoignés par le spectacle, quoique plusieurs d’entre eux le connaissent déjà. Parfois une branche plus sèche étant lancée sur le brasier, la gerbe de feu qui en résulte monte plus haute, et les tours, illuminées de la base au faîte, sortent un instant des ténèbres comme des décors fantastiques, puis s’y replongent brusquement. Les étincelles jaillissent jusqu’au balcon où s’accoudent les spectateurs, et les coups de plus en plus violents frappés sur la peau sonore créaient des vibrations extraordinaires.
Enfin les trépignements s’accélèrent; les voix pressent leur débit saccadé tandis que redoublent sur les tam-tams le choc des mains impatientes. Sous les pieds des danseuses énervées, la terre rend un son mat, et les têtes en se secouant font voltiger des franges de foulards et des éclairs de bijoux. Le géant qui frappe son tambour primitif lance une clameur gutturale; et tout à coup c’est l’immobilité, le silence, rompu soudain par le rire hennissant d’une Chleuha dont l’exaltation veut s’épancher, coûte que coûte, hors de la limite imposée.

Plus tard, le grand feu d'antan a été remplacé par un petit feu
où les musiciens présentent leur bendir à la flamme, ce qui a pour effet de tendre la peau.
Photo René Bertrand
La danse tient incontestablement une place de choix dans la culture berbère. Phénomène essentiellement rural, il s’agit habituellement d’une manifestation d’un haut niveau esthétique, à la mise en scène aussi symbolique que suggestive, sans doute liée à quelque thème de fécondité issu du fond des âges. Exutoire commode, en tout cas, pour des populations menant une existence rude, elle ne peut laisser l’observateur indifférent. Au mieux, elle le charmera grâce à son “mysticisme immanent se répercutant en ondes qui atteignent très profondément la sensibilité” (Mazel, 1971, p. 226).
Depuis le Rif jusqu’à l’Anti-Atlas, les danses berbères se succèdent, aussi nombreuses que variées; raison pour laquelle il pourrait s’avérer fastidieux d’en établir un inventaire exhaustif. Tout au plus se contentera-t-on d’en citer les plus connues, d’en évoquer les traits caractéristiques, et de les situer dans l’espace marocain.
L’ahouach et l’ahidous
A l’avant de la scène c’est le tandem ahouach/ahidous qui prédomine, tant par son extension territoriale englobant l’ensemble du monde atlasique, que par les connotations culturelles et linguistiques qu’il renferme. En effet, l’ahouach s’identifie directement à l’aire tachelhit, donc aux populations sédentaires appelées communément “chleuh”, plus exactement Ichelhayn. C’est dire qu’il se pratique dans l’Anti-Atlas, le Haut-Atlas occidental, et le Haut-Atlas central jusqu’à une ligne imaginaire (très perméable, aussi) allant de Demnate à l’assif Mgoun. Fait intéressant, du reste, c’est dans cette zone de contact que l’on assiste, depuis une trentaine d’années, à une poussée inexorable de l’ahouach au détriment de l’ahidous, selon le musicologue Lortat-Jacob (1980, p. 68) qui a effectué un travail fort sérieux dans ce domaine. A telle enseigne, que les Aït Mgoun sont totalement gagnés par le phénomène, lequel s’étendrait également aux Aït Bou Ouli.
Plus à l’Est, cependant, l’ahidous règne en maître chez les ksouriens transhumants de parler tamazight du Haut-Atlas oriental, dont il constitue la danse de base, ainsi que chez leurs cousins du Moyen-Atlas. Ensemble que le lecteur aura reconnu comme appartenant au groupe dit “beraber” (imazighen). L’ahidous (prononcé parfois haydous) parvient à franchir les limites nord-est du pays amazigh, puisqu’on constate sa présence chez les Aït Ouaraïn, groupe important dont le parler s’apparente à la znatiya.
Une danse villageoise : l’ahouach
Les deux danses, en vérité, sont assez différentes sur le plan chorégraphique. Dans l’ahouach les tambours, qui sont démunis de timbre, peuvent jouer des rôles spécifiques, voire être de tailles différentes, en particulier dans l’Anti-Atlas (cf. Mazel,1971, p.232 et fig. 16; “Danse des femmes à Assa”, Montagne, 1930, p. 5). Quant à l’agencement, variant superficiellement d’une région à l’autre, il peut compter deux (Lortat-Jacob, 1980, p. 69), même trois parties (Chottin, 1948, p. 46). Il comprend parfois un unique rond de femmes (Morin-Barde, 1963, p. 78), parfois deux alignements se faisant face (Jouad / Lortat-Jacob, 1978, p. 74-75), s’infléchissant souvent en demi-cercle, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Séparation des sexes destinée à éviter tout mécontentement de la part d’un mari jaloux (Lortat-Jacob, 1980, p. 66). Pour ce qui est du rythme il est soit à deux, soit à quatre temps.
Les ahouach les plus somptueux semblent avoir été ceux exécutés à Telouet, fief du Glaoui, du temps du Protectorat (Mazel, 1971, p. 230). Les Glaoua, on le sait, sont passés maîtres dans cette forme artistique, au point que d’aucuns prétendent que l’ahouach aurait pu avoir pour terroir natal le pays Glaoui, supposition que récuse Lortat-Jacob (1980, p. 65). S’il reconnaît une certaine primauté en la matière aux Glaoua (Mazel, 1971, p. 230) vante également les qualités des ahouach que l’on peut admirer à la kasbah de Taourirt, Ouarzazate. Spectacle d’un genre qui, malgré toute accusation de galvaudage touristique, plus ou moins justifiée, n’en conserve pas moins une réelle valeur folklorique - au sens noble du terme.
Bien qu`aucune description ne soit à même de faire honneur à la gestuelle d’un pareil spectacle, voici ce qu’en dit Chottin (1948, p. 546) : “Danse tout d’abord verticale et sur place, sans d’autres mouvements que dans le sens de la hauteur. “Les bras le long du corps, la femme, dans une ondulation serpentine, fléchit légèrement les genoux, projette le bassin en avant, inclinant en même temps la tête sur la poitrine; ensuite, dans un mouvement inverse, elle opère une extension de tout le corps de bas en haut, qui aboutit au rejet de la tête en arrière; puis le cycle recommence”.
Ces ahouach de Ouarzazate sont surtout le fait des Aït Ouaouzguit, autres spécialistes du genre, groupe occupant un territoire assez vaste sur la retombée sud du Toubkal. Chez eux, nous avons eu le privilège d’assister à un ahouach moins formel un soir d’Aïd el Kebir au clair de lune. Sans parler d’autres manifestations de facture différente, allant du délicieux ahouach impromptu des jeunes filles du pays Seksaoua, à un ahouach de circonstance un jour de fête officielle à Imi n-Ifri, près de Demnate, ainsi que de superbes choeurs berbères sur le plateau du Tichka (Berque, 1955, p. 164, pl. XI).
Les tambourinaires d’ahouach méritent une mention spéciale. En début de soirée, un feu ayant été allumé au milieu de la place publique (assarag), ou au centre de la cour de quelque fière kasbah, chaque tambourinaire approche son instrument de la flamme afin d’en tendre convenablement la peau, ceci dans le but d’obtenir une sonorité optimale. Chez les Aït Mgoun, il se lèvent alors et jouent debout pendant les premiers mouvements de la danse. Ce n’est qu’une fois l’harmonie rythmique bien installée entre les deux rangées qu’ils s’accroupissent pour ne pas obstruer le champ visuel des danseurs (Lortat-Jacob, 1980, p. 66). Dans d’autres cas toutefois, les tambourinaires représentés comme restant accroupis au centre du cercle en début de danse. (Mazel, 1971, p. 231; Garrigue, 1964, p. 137).
Aouach, danse du pays chleuh
L’Ahouach est à la fois le nom générique donné à la musique de village et le nom d’une danse typique du pays chleuh (Haut-Atlas, Anti-Atlas et Souss). Se pratiquant à l’occasion de toutes les célébrations collectives, ce sont des villageois volontaires qui en assurent l’exécution. C’est une danse mixte précédée d’un chant dialogué, une sorte de joute appelé l’msaq.
Les chants et la musique sont le moyen d’expression le plus explicite dont disposent les Berbères des hautes vallées marocaines. Le chant et la danse sont pratiquement inséparables. Les éléments de cet art sont le rythme, la mélodie et la chorégraphie. Il y a dans nos montagnes des meneurs de jeu, des rwaïss (chefs de chant) particulièrement dynamiques, tel celui dont Florent Schmitt disait, en le voyant évoluer sur le front de ses cinquante choristes, le tambourin levé, le geste altier : "Cet homme est un chef d’orchestre né, il surpasserait Toscanini." Dans les chants berbères, le tempérament est l’essentiel. La culture et l’art ne sont que des moyens au service du génie. A travers toute la musique berbère, le rythme est la base fondamentale.
Un thème poétique est proposé, une phrase est lancée : "Les cœurs de tous les hommes doivent aspirer au bonheur. L’amour doit être le thème de la vie de notre tribu". Là-dessus, le thème musical se brode, très simple, rustique, sur deux ou trois notes, de sorte qu’il s’agit beaucoup plus d’une déclamation, d’une mélopée extrêmement fruste. Le rythme aussitôt s’en empare, lui donne une forme, une structure rigide que la danse va rendre visible, plastique, efficiente. Très souvent c’est une cérémonie nocturne organisée à l’abri de ces constructions en pisé que sont les Kasbahs aux tours audacieuses qui défient le ciel et dominent la vallée. Et voici que les cours s’emplissent d’ombres et de murmures, un feu de branches légères flambe pour réchauffer la peau des tambourins qui vont vibrer toute la nuit dans le silence de la vallée, et la flamme éclaire les beaux visages souriants des jeunes filles berbères. Des silhouettes fantastiques animent les murs crénelés qui se perdent dans la nuit. Au crépitement du bois répond la vibration sourde des tambourins.
Les danseuses de l’ahouach, aux longues robes de soie, aux coiffures multicolores, prennent rang dans la ronde, alors qu’au centre, près du feu, sont assis une douzaine d’hommes, tous munis d’un bendir (grand tambourin rustique) qui résonne maintenant comme une cymbale. Une voix s’élève, rude, étranglée, suraiguë : un chanteur propose un thème qui se cherche, hésite, repart. Il jette une sorte d’appel vers l’espace, puis s’écoute, se recueille dans le grave, s’élance tout à coup vers les cimes en bondissant, et s’arrête soudain comme épuisé. Mais déjà un second chanteur reprend la cantilène ébauchée. La mélodie, encore sans relief, précise sa ligne. C’est l’msaq. Pour les gens du pays, c’est ce chant dialogué qui est la partie la plus appréciée et aussi la plus difficile à réussir. C’est également la plus surprenante par son originalité pour les spectateurs non initiés.
L’msaq nécessite la participation d’au moins un improvisateur. Mais il est préférable qu’il y en ait deux ou davantage pour qu’il y ait émulation. Il faut également un groupe de tambourinaires et deux choeurs de femmes. Les deux choeurs se tiennent debout en deux rangées se faisant face, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Ces choeurs doivent être denses, afin d’obtenir un effet de masse chorale compacte sans lequel le chant est jugé inesthétique. L’exécution commence avec l’intervention d’un soliste improvisateur. Il chante une suite de vers appelée "tour de rôle" ou "répartie". Le chœur masculin lui répond en premier, puis vient le tour du chœur des femmes. Un autre soliste intervient avec une nouvelle répartie, puis à nouveau les choeurs et ainsi de suite. les phrases, ponctuées aux tambours sur cadre avec une lenteur solennelle, sont très étirées. les tambourinaires frappent du plat de la main, avec un léger décalage, de manière à obtenir un effet de répercussion, "comme celui d’un muret de pierres qui s’écroule", a-t-on l’habitude de dire. Après un certain nombre de réparties, l’msaq entame une lente évolution (sans transition sensible) qui finit en danse : l’ahouach proprement dit Alors, sur toutes les peaux tendues, un coup formidable retentit qui ébranle toute la Kasbah. La phrase musicale est jouée. Puis d’autres coups surviennent qui en ponctuent à intervalles espacés et réguliers les diverses périodes. Le thème ainsi établi est passé aux hommes et aux femmes qui l’entonnent en chœur.
A cette majestueuse introduction succède l’impérieuse cadence des bendirs. La ronde des femmes commence à onduler. Après une dizaine de reprises, le raïss élève son tambourin au-dessus de la tête; aussitôt le rythme change et s’accélère. Il était binaire, il est maintenant ternaire. Les hommes se taisent et battent seulement du bendir, achevant l’ahouach dans un paroxysme fantastique, souvent accompagné d’une clameur : le tazghaght. Le cercle mouvant des femmes se partage en deux arcs qui s’écartent peu à peu l’un de l’autre, s’allongent et se font face. Ainsi se forment deux demi-choeurs : le premier reprend le motif chanté par les hommes et le second lui donne la réplique. L’ahouach qui symbolise la vie même de la tribu réunie autour de son foyer, du feu sacré des anciens, est à son point culminant.
Bibliographie :
Lortat-Jacob Bernard : Musique et fêtes au Haut-Atlas. Cahiers de l’Homme, Mouton éd. 1980
Mazel Jean : Enigmes du Maroc. Laffont 1971