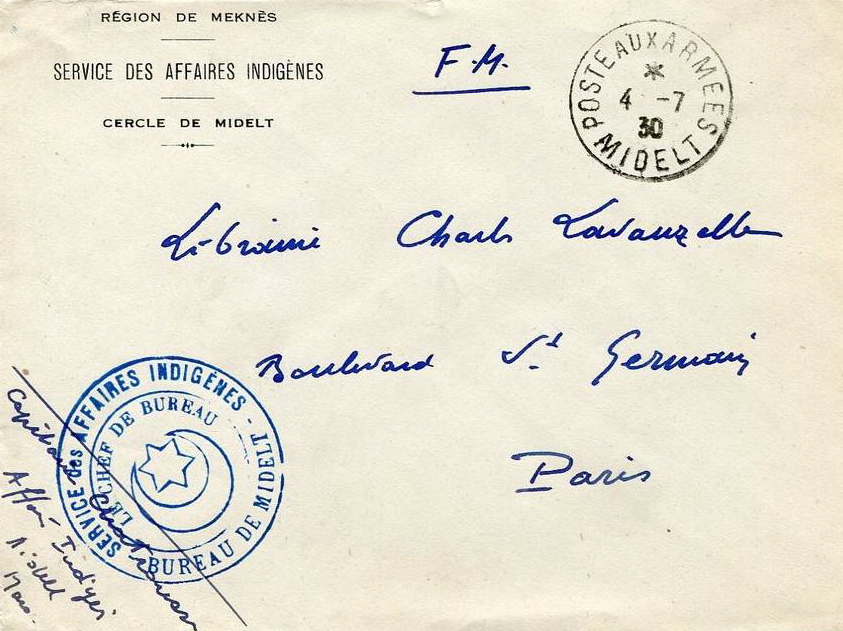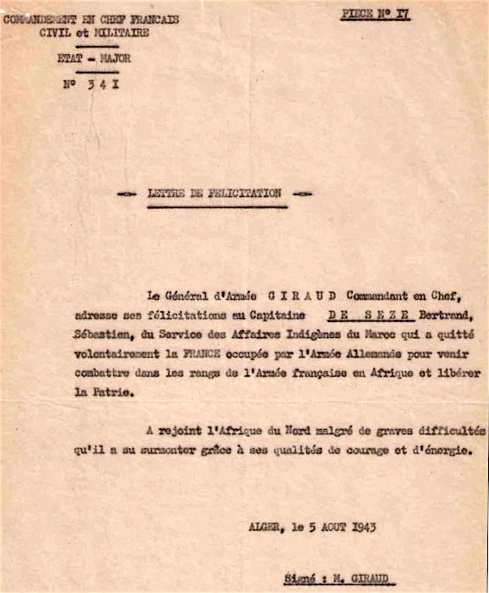Affaires indigènes
L'officier des Affaires Indigènes
Mis à jour : lundi 12 décembre 2016 19:58Les candidats pouvaient avoir déjà fait partie des Services des Affaires Indigènes d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, et en être sortis. Dans ce cas, s’ils y avaient donné satisfaction, ils étaient repris sans être obligés de repasser par le Cours des A.I.
Le recrutement
Le recrutement se faisait en fonction des notes de l’officier qui demandait à entrer dans le Corps des Affaires Indigènes. Il n’y était définitivement admis qu’après le passage réussi dans un cours de perfectionnement, appelé couramment “Cours des A.I.”.
En dehors des bonnes notes, aucune condition particulière n’était exigée. Les candidats pouvaient venir des tous les horizons, de toutes les armes, du rang ou des Ecoles. Les motifs les plus divers pouvait les inciter à demander leur admission dans le Corps. Avant 1934, ce pouvait être l’appel des armes du “baroud” lié à l’attrait de la diplomatie : car il fallait être à la fois un homme de guerre et un homme politique. Après 1934, ce fut le goût de l’organisation, de l’administration, du contrôle, lié au goût de la justice et du commandement, et, essentiellement, le goût du contact et l’amour de l’Homme.
L’officier des A.I., qui devait être un homme de paix, un administrateur, devait aimer étendre ses connaissance, se documenter, lire, réfléchir. C’était parmi ces hommes que ce faisait le meilleur recrutement. C’est dans ce sens que fut donné l’enseignement du Cours des A.I.
En janvier 1913, il y avait 194 officiers aux A.I. du Maroc, 305 en 1928 et 580 avant la Seconde Guerre mondiale. Le nombre n’a jamais atteint 600 ensuite jusqu’à l’Indépendance.
Le Cours des A.I.
Pendant neuf mois, les officiers, mêlés aux apprentis contrôleurs civils, allaient avoir à absorber un programme fort chargé, dispensé par les meilleurs professeurs et spécialistes des choses du Maroc. Le nombre d’officiers admis aux cours était généralement de 25 à 35. Les programmes, dans leurs grandes lignes, comportaient d’abord l’étude des langues parlées, arabe, berbère, et même quelques notions d’espagnol. Il y avait ensuite la connaissance du Maroc, son histoire et sa géographie. Quelques leçons sur l’Islam en général, les institutions musulmanes, le monde musulman, son histoire et son évolution, étaient indispensables.
Appelés à travailler avec les services techniques, les élèves devaient un peu connaître les techniques des services agricoles, du génie rural; des eaux et forêts, du service des mines. Ils devaient même acquérir quelques rudiments de médecine vétérinaire appliquée car c’étaient eux qui devaient visiter les carcasses du bétail abattu sur les souks, avant leur mise en vente. Une place très importante était tenue par l’étude du droit, droit musulman, droit coutumier berbère, et quelques notions de droit administratif, de droit privé français et de droit international.
Jusqu’à la guerre de 1939, le programme comportait même des cours d’équitation. Cela pouvait passer pour un délassement en dehors des cours, mais en réalité c’était bien dans la droite ligne de la pensée de Lyautey, qui voulait que les contrôleurs et les officiers passent le plus clair de leur temps, non derrière leur bureau, mais à cheval au milieu des tribus. Et c’est ainsi que tous les matins, on pouvait voir évoluer, avec plus ou moins d’aisance, les élèves dans la carrière du quartier des spahis. Certains jours, ces reprises étaient remplacées par des parcours en groupe dans les allées cavalières des bois de l’Aguedal à Rabat, où, pendant les années qui ont précédé la guerre, ils rencontraient parfois, escorté par un sous-officier français de la Garde Noire, un tout jeune garçon qui montait crânement un petit cheval. C’était le Prince Impérial, futur hassan II.
Après avoir, pendant neuf mois, consciencieusement absorbé ce copieux programme, il restait aux élèves à franchir le dernier obstacle : l’examen de sortie, qui était sérieux et que tous ne franchissaient pas. Ils étaient classés d’après leurs notes et, dans l’ordre, ils choisissaient le poste qu’ils désiraient. Ils étaient alors, par décision résidentielle, “placés hors cadres”, mis à la disposition du Résident général pour être employés au service des A.I. Dispersés ensuite dans tout le Maroc, ils étaient nommés, au départ du Cours, adjoints stagiaires dans la hiérarchie spéciale des Affaires Indigènes.
Les fonctions très particulières remplies par les officiers d’A.I. faisaient que les postes qui leur étaient confiés, l’étaient davantage en fonction de leur compétence, de leurs connaissances et de leur expérience, que de leur grade militaire... Cela justifiait la création d’une hiérarchie spéciale indépendante du grade.
L’officier, le plus souvent lieutenant, parfois capitaine, qui sortait du Cours des A.I., après avoir été nommé en poste adjoint stagiaire, passait adjoint de 2ème classe puis adjoint de 1ère classe. Chef d’Annexe, il était chef de Bureau de 2ème classe, puis chef de Bureau de 1ère classe.
Les chefs des Cercle, en principe officiers supérieurs, étaient généralement chefs de Bureau hors classe. Le plus souvent, les chefs de Postes étaient lieutenants ou capitaines. Les chefs d’Annexe étaient capitaines, les chefs de Circonscription étaient capitaines ou commandants, les chefs de Cercle, commandants ou lieutenants-colonels. Les chefs de Région étaient des officiers généraux.
Les officiers des A.I. percevaient une indemnité payée sur le budget du Protectorat, en sus de leur solde militaire. A noter que les officiers des A.I. étaient nettement désavantagés dans leur avancement par rapport à leurs camarades des corps de troupe et des états-majors.
Le rôle de l'officier des A.I. sur le terrain
C’est vraiment dans l’oeuvre des officiers des A.I. que l’on touche le tour de force du génie français que des soldats, instruits et équipés pour les actions de guerre, se soient transformés instantanément en administrateurs... avec tout ce que cette fonction comportait de doigté, de cran, de science, d’activité.
En réalité, les combats étant fini, les tribus ayant déposé les armes, les officiers français qui, à la tête des partisans et des soldats réguliers, avaient conquis le terrain, durent l’organiser aussitôt.
Rarement des hommes purent mieux qu’au Maroc donner la mesure de leur valeur. Ils arrivaient dans un pays où rien n’existait que le désordre et l’anarchie, et là, dans ce néant, ils créèrent tout.
Les officiers des A.I. durent tout faire, tout comprendre, tout savoir, tout réaliser.
Ils commencèrent par tracer des pistes qui se transformèrent bientôt en routes. D’abord, ces pistes furent un gage de sécurité puisque avec des effectifs réduits mais mobiles, ils purent faire la police sur de vastes étendues. Ces pistes furent également un gage de développement économique, puisqu’elles permirent la circulation et les échanges.
Les officiers des A.I. continuèrent leur rôle en organisant la justice, ensuite ils installèrent des souks où les gens des ksour vinrent faire leurs achats et où les blédards purent apporter leurs produits, se ravitailler et en final “s’apprivoiser”.
Les officiers des A.I. équipèrent le pays, du point de vue économique, médical et social. Ils ouvrirent des centres de consultations, des infirmeries indigènes, des sociétés de prévoyance et luttèrent contre l’usure (lèpre des populations primitives).
Ils furent des chefs de l’état civil pour les indigènes et aussi pour les Européens, qui bientôt arrivèrent : commerçants, hôteliers, mineurs, personnel d’administration (poste, eaux et forêts, etc.) ou ménages d’officiers.
Ils perçurent l’impôt mais aussi distribuèrent les secours en cas de famine ou d’épidémie. Ils dépistèrent les maladies, qui, trop souvent, sévissaient sur les individus, sur les troupeaux et sur les récoltes.
Pour un Français, quel destin merveilleux fut celui de ces hommes, égal à ceux qui peuplent les récits fantastiques des contes arabes, où l’on voit des bergers devenir soudain conquérants et rois de vastes empires.
D’après un reportage de Pierre Dumas pour la revue Sud-Ouest économique, numéro spécial sur le Maroc de 1936.
Un officier des A.I. (le hakem), en tournée
Chikaya, tertib, travaux, ces multiples obligations imposaient au hakem une forte présence dans tous les secteurs de son territoire. Les directives officielles lui prescrivaient d’ailleurs des tournées fréquentes en tribu. Il les faisait à cheval, non seulement parce que les routes étaient rares, mais parce que les officiers des A.I. avaient créé une sorte de tradition. Les tournées prenaient donc la forme de chevauchées campagnardes.
“Les soirs de tournées, quand mes Mokhaznis et ceux du caïd avaient dressé nos tentes, on allumait un grand feu et on faisait battre le “bendir”. Les Berbères transportent toujours avec eux quelques uns de ces grands tambours plats, aussi indispensables que le fusil. Au bout d’un assez long temps on voyait sortir de l’ombre environnante, semblables à des phalènes, d’abord des hommes avec d’autres bendirs, puis des femmes qui avaient pris le temps de se parer de leurs foulards de soie et de leurs lourds colliers de monnaies d’argent. L’ahidouz commençait alors. Le poète local (car on a toujours un poète sous la main en pays berbère) lançait une phrase à pleine voix, louanges de circonstance que reprenait le chœur des hommes, puis celui des femmes, tandis que les rangs affrontés des danseurs et des danseuses, les paumes jointes dans un geste rituel, ondulaient de gauche à droite et de droite à gauche, au rythme de la mélodie lourdement scandée...”
André Hardy
La création et l’entretien des pistes, premier souci
Au temps de la dissidence, l’économie était fruste et les pistes muletières qui serpentaient dans la montagne, reliant les douars isolés aux points importants : souks, marabouts, demeures de notables ou de chorfas, arbres sacrés où se prêtaient les serments, suffisaient largement à la satisfaction des usagers. Rarement, pour ne pas dire jamais entretenues, ces pistes, créées à force de passages, suivaient dans la montagne des tracés utilisant les cols. Mais elles ne craignaient ni les fortes pentes, ni les abrupts où les pieds des mules se sentaient à l’aise. Pour les opérations militaires, il fallut ouvrir des routes à la circulation des convois; le Génie militaire y contribua, mais aussi la troupe et particulièrement la Légion.
Le développement d’un souk ou la création d’un nouveau marché amenaient vite autocars et camions. Les gués des oueds ne suffirent plus et la construction de radiers se révéla bientôt nécessaire pour traverser en véhicules automobiles des rivières généralement à sec, mais infranchissables en cas d’orage. La pacification au Sud de l’Atlas terminée, la construction et l’entretien des pistes incombèrent aux Affaires Indigènes. Ce sera un de leurs soucis primordiaux constants, car l’économie en se développant et en se diversifiant, nécessita de nouveaux axes de pénétration. Mais les crédits officiels étant forts limités dans les régions lointaines, il fallait faire appel aux corvées (touizas) et aux prestataires. Pour l’entretien courant, la piste était partagée en secteurs sous la responsabilité des différentes fractions de tribu dont elle dépendait. Survenait-il un orage ? Sans autre indication, le cheikh du secteur envoyait ses hommes réparer les dégâts : les autorités, le médecin, la voiture postale, le ravitaillement devaient pouvoir passer. Lorsque les dégâts étaient plus importants, un mokhazni était détaché du poste avec des outils, des gabions, et il remettait en état avec l’aide de la tribu, le radier emporté par la crue. C’était un travail important et certains mokhaznis chevronnés avaient acquis l’expérience de ce genre d’ouvrage délicat, car s’il était mal refait, le radier était emporté par l’orage suivant. La création d’une piste requérait la plus grande exigence : de nombreuses reconnaissances étaient nécessaires avec goniomètre-boussole et alidade nivélatrice pour faire au départ le point de stationnement et repérer les principaux accidents du terrain, et aussi avec sitomètres et mires pour rechercher le meilleur tracé, la pente la plus faible avec le minimum de terrassement. Les archives, les précédentes études de terrain - souvent accompagnées de projets faits par les prédécesseurs - apportaient de précieuses indications. Parfois la construction d’un pont était nécessaire, et l’aide du Génie rural ou militaire (avec la Légion) était requise pour réaliser les travaux. La création et l’entretien des pistes représenta un chapitre important du travail des Affaires Indigènes qu’on retrouve dans toutes les fiches de tribu et dans tous les passages de consignes.
Le rôle civil
L’officier des A.I. doit s’intéresser à toutes les activités. C’est un politique, un administrateur, un contrôleur, un économiste en plus d’être un militaire. Mais c’est aussi un homme célibataire ou marié, et parfois un père de famille en poste. C’est aussi un homme qui arrive à avoir des loisirs et qui se distrait selon ses goûts. Souvent c’est un chasseur, mais parfois il dessine ou peint. La paméonthologie ou la recherche des gravures rupestres fut aussi un passe-temps goûté de quelques officiers.
La chasse, l’abondance du gibier, lèvres, perdrix, sangliers permettaient aux officiers d’assouvir ce qui, pour beaucoup était une passion, et pour certains une manière de rémédier à la monotomie obligée des repas. Le ravitaillement dans les postes éloignés des grands centres était limité et il fallait parfois recourir à la chasse, parfois même à la pêche pour pouvoir varier les menus et recevoir dignement les hôtes de passage.
Les premiers ethnologues du Sud marocain
Au cours du Protectorat, une chaire de berbère fut créée à Rabat et une expérience d’intégration du berbère dans l’enseignement secondaire fut conduite au collège d’Azrou, dans le Moyen-Atlas. Durant toute cette période, la production dans le domaine des études berbères fut très importante. En dehors de l’université de Rabat, les autorités civiles et militaires ont fortement contribué au développement des travaux consacrés à la langue berbère. En effet, à partir de 1934, après les derniers combats de la pacification dans le Sud marocain, la tâche des officiers des Affaires Indigènes étant devenue politique et administrative plutôt que militaire, certains d’entre eux s’attachèrent à mieux connaître les populations dans le seul but de les contrôler et de les surveiller, d’autres, au contraire, donnèrent à la sociologie, à la linguistique ou à l’ethnologie des Berbères du Maroc quelques-uns de ses plus éminents spécialistes, même si on a pu leur reprocher une vision des choses maintenant dépassée ou un certain manque d’objectivité. Profitant d’une affectation qui leur valait de séjourner plusieurs années dans un milieu berbérophone, beaucoup d’officiers des A. I. en ont profité pour découvrir une langue, un mode de vie et des systèmes de pensée dont l’étude a abouti à des publications qui font encore référence aujourd’hui pour certains dialectes ou la connaissances des mœurs et coutumes de certaines fractions de tribus des djebels au Sud de l’Atlas ou des régions présahariennes. Bien qu’utilisant parfois une terminologie maintenant obsolète (race, indigène), les travaux réalisés dans la première moitié du XXe siècle demeurent encore appréciables, à la fois par leur apport linguistique et pour l’intérêt ethnologique des textes recueillis. La majeure partie des travaux et études ont été publiés dans Hesperis, revue de l’Institut des Hautes Études Marocaines et des Archives Berbères, dont le but fut, pendant quarante ans, l’étude du Maroc, de son sol, de ses populations, de leurs civilisations, de leur histoire, de leurs langues.
Le général de Saint Bon
Un grand nom des A.I.
Sorti de Saint Cyr le 1er juillet 1924, il est nommé sous-lieutenant le 1er octobre.
Après le 1er Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.) à Wissenbourg (Bas Rhin) et instructeur d’un peloton d’EOR à Saint Avold, il est affecté au 62ème Régiment de Tirailleurs Marocains à Marrakech le 15 février 1927.
Eté 1927 : tournées de police dans le cercle d’Azilal;
Automne 1927 : pacification des Ida ou Tanane au nord d’Agadir (citation à l’ordre de la division);
Printemps 1928 : combat de Dar Lahoussine ou Aomar (citation à l’ordre du corps d’armée);
Eté 1928 : le lieutenant de Saint Bon dirige les convois muletiers entre Telouet et Ouarzazate.
Nommé lieutenant le 1er octobre 1928, il suit pendant neuf mois le cours préparatoire au service des Affaires Indigènes à Rabat.
Il servira alors de 1929 à 1937 au service des Affaires Indigènes dans le Sud marocain :
- du 1er juillet 1929 au 18 juin 1931 : adjoint stagiaire au bureau des Affaires Indigènes de l'annexe de Chichaoua puis à celui d’Imi n’Tanout;
- du 18 juin 1931 au 06 avril 1932 : affecté au cercle de Ouarzazate;
- du 6 avril 1932 au 1er juillet 1934 : adjoint au bureau des Affaires Indigènes de Zagora, travail de renseignement sur le Tazzarine et le Taghbalt (citation à l’ordre de l’armée);
- chef du bureau de Tagounit, participe aux opérations du Saghro (citation à l’ordre de l’armée et citation accompagnant sa nomination à titre exceptionnel au grade de chevalier de la Légion d’Honneur);
- participe ensuite aux opérations de Tindouf;
- du 1er juillet 1934 au 21 avril 1937, adjoint au bureau des Affaires Indigènes du cercle de Taroudant.
Promu au choix au grade de capitaine le 25 décembre 1934, il sert en France jusqu’à juin 1940.
Mis en congé d'armistice le 1er novembre 1940, il passe la frontière algéro-marocaine à Oujda le 30 novembre 1940 et est recruté dans le corps des contrôleurs des Affaires Indigènes du Maroc comme adjoint au secrétariat général de la région de Meknès le 5 décembre 1940.
Promu chef de bataillon le 25 juin 1941, il commande les goums de la région d’Agadir (PC à Tiznit) et prend le contrôle de la méhalla chérifienne de Tiznit le 1er septembre 1941.
Affecté au commandement provisoire du cercle de Taroudant le 16 octobre 1941, il est rayé du corps civil du contrôle des Affaires Indigènes et réintégré dans l'armée d'armistice pour exercer les fonctions de chef du cercle de Taroudant le 1er novembre 1941.
Adjoint à Sefrou au commandant du 3ème Groupe de Tabors Marocains (3ème G.T.M.) le 1er juin 1943. Il fait la campagne d’Italie et de France, de 1944 à 1945, avec les Goums Marocains. Obtient deux citations et la rosette de la Légion d'Honneur à titre exceptionnel.
Promu lieutenant-colonel le 25 octobre 1944, il est affecté à la délégation en AFN des Affaires Indigènes (détaché au secrétariat général du comité d'Afrique du Nord) à Paris, du 1er mars 1945 à avril 1947.
Commande du 15 avril 1947 au 30 janvier 1951 l'Ecole Militaire des Elèves Officiers Marocains à Dar el Beïda (Meknès).
Promu colonel le 1er juillet 1950, il est nommé chef et commandant du territoire de Tiznit du 1er février 1951 à octobre 1951, puis Chef du cabinet militaire du résident général de France au Maroc (général Guillaume) du 1er octobre 1951 au 9 février 1954.
Commande le 2ème Régiment de Tirailleurs Marocains à Marrakech du 10 février 1954 au 10 mai 1956.
Promu général de brigade le 1er février 1960, il est rayé, sur sa demande, des contrôles de l'armée d'active le 1er août 1960.
La vie en couple d’un officier des A.I. à Ouarzazate en 1940
Gisèle Nesmon, dans son roman Le fils de l’Hégire (Edition SDE 2004), donne une vision intéressante de la vie d’un officier des Affaires Indigènes en poste à Ouarzazate dans la période troublée du début de la seconde guerre mondiale...
Le personnage du capitaine est évidemment fictif mais Gisèle Nesmon, par ses descriptions, montre qu’elle est bien informée sur la vie de l’époque.
Je me suis permis de présenter des extraits les plus représentatifs de son chapitre intitulé “Ouarzazate 1940”, particulièrement son analyse politique de l’époque et sur l’action d’un officier des A.I. secondé par son épouse intervenant dans le social auprès des populations.
L’histoire avançait malgré lui, Henri assuma sa condition d’officier des A.I. sans le moindre complexe et ne renonça à aucun de ses pouvoirs, trouvant une liberté totale qui le faisait vivre complètement. Il contrôlait les vallées du Dadès et du Drâa ainsi que les versants sud du Haut Atlas et tout le Jebel Saghro. Il administrait près de 500 000 habitants et tout un cheptel qui, entre les chameaux, les chevaux, les mulets, les bœufs, les moutons et les chèvres, dépassait le million de bêtes. Il était au cœur du pays Glaoua qui avait à sa tête le Glaoui, Pacha de Marrakech. Les ksour tenaient la lisière des montagnes, les points névralgiques des plaines. Ces hautes demeures fortifiées avaient autrefois répondu au souci de protéger les populations villageoises contre les attaques éventuelles des tribus voisines.
... Le capitaine Henri X... entretenait avec les Berbères des rapports d’équité. Au cours des traditionnelles assemblées - les Jemâa - il constatait que les caïds rendaient plus d’arrêts que de services. Ils exploitaient sans vergogne les tribus soumises à leur commandement théorique. Souvent il se devait d’intervenir pour rétablir une justice prompte, impartiale, en prenant le parti des petites gens accablés d’impôts, encore terrorisés par le souvenir des razzias punitives d’avant le Protectorat. Cette droiture le faisait très vite fraterniser avec ses administrés et de ksar en ksar, il avait la réputation d’un homme honnête et généreux à qui l’on s’adressait en toute confiance.
“La justice est un pari sur l’homme. Elle est indispensable à sa dignité.” Il ne se rappelait plus où il avait lu cette phrase mais elle appuyait son quotidien. Le monde berbère était pour lui une attraction, amour parfois et exaspération le plus souvent.
... Le capitaine n’avait pas le temps de rêvasser. Il était pris par les affaires et la politique sociale. Il faisait les interminables du cahier des charges dans lequel toutes les marchandises, la paie des ouvriers, la solde de ses militaires étaient répertoriées. Plus tard il mettrait à jour la liste récapitulative des décès, des naissances et des mariages. Quelques rares divorces étaient à inscrire; “Casser la carte” était pour beaucoup la seule expression qui accompagnait cet acte de rupture. Henri, très attentif, savait que les uns n’étaient pas à leur première annulation. Quant aux autres, celles-ci étaient escortées par toutes sortes de procédure dont voulait uniquement tirer profit. L’officier soupira et constata que le Droit français avait bouleversé bien des dogmes. Le divorce était mal perçu par l’Islam qui y voyait avec le Prophète “la chose la plus haïssable pour Dieu”. Il était dit : “Épouse toujours, ne divorce jamais”. Cependant il ne convenait pas d’abandonner femmes et enfants sans ressources et les lois françaises n’étaient pas toujours comprises ni acceptées par une population uniquement instruite du Coran.
... Henri regrettait sa fatigue, son esclavage, tout ce qui faisait qu’il s’oubliait lui-même. Du haut de sa selle, il pensait à Louise, sa femme aimée. Avec elle, l’amour était rassurant parce que raisonnable et bon, salutaire à son esprit. Il reconnaissait encore qu’elle comprenait sa carrière si particulière d’officier des A.I. Elle se préoccupait même de la conforter, reconstituant un milieu heureux à celui qu’elle appelait “son cher ange”. Le couple qu’elle formait avec Henri était une chose vraie, noble et vivante. Une petite fille, Claire, était née voici cinq ans.
... Dans leur maison, seul écho d’un monde lointain, une TSF placée sur un coffre en bois de cèdre. Les nouvelles, les programmes en provenance de France arrivaient brouillés. Ils avaient du mal à passer l’écran des montagnes de l’Atlas. Cependant le couple essayait de faire de chaque soirée un festival d’opérettes, de chansons. Les artistes français leur faisaient oublier la tragédie de la guerre qui frappait l’Europe. La voix veloutée d’un Jean sablon était en harmonie avec le silence de la nuit. La grosse aiguille du phonographe traçait les sillons du “Petit chemin qui sent la noisette” et “Vous qui passez sans me voir” étaient des notes d’amour adressées au monde entier.
Parmi les livres sauvés des déménagements, se trouvaient deux tomes de recettes de cuisine. Les feuilleter était affamer les estomacs les plus gourmets. Le saumon à l’oseille, le canard à l’orange, les glaces aux divers parfums devenaient des rêves purs. Pour Louise, ces savantes recettes restaient de vieux souvenirs de jeunesse. Cependant ils étaient des thèmes d’évasion, des jouissances solitaires car la région du Haut Atlas regorgeait de fruits, de légumes, de viande de toutes sortes. Le gibier y était abondant et le cuisinier composait des plats aux heureux mélanges d’épices.
Dans une annexe du bureau des A.I., Louise avait tenu à ouvrir un dispensaire. Cette assistance médicale avait ravi le médecin commandant du Fort. Il se trouvait ainsi soulagé d’un bon nombre de petits bobos; apprendre les rudiments d’hygiène à toute une population attardée ne l’avait jamais mobilisé.
Montée sur un mulet et accompagnée d’un mokhazni, Louise emportait dans une besace tout le matériel nécessaire aux soins. Trois matins par semaine, elle visitait les ksour, villages qui se succédaient, fondus en un mimétisme parfait dans les replis des falaises.
Lorsque Louise poussait une porte, les femmes la saluaient en lui souhaitant longue vie et en frappant du pied sur le sol afin de faire fuir les mauvais esprits. Louise retirait ses sandales; elle montrait ainsi qu’elle ne prenait pas possession de la maison. Henri lui avait expliqué que les Berbères vivaient avec les esprits et les morts, intermédiaires entre l’homme et l’invisible. Ils étaient les immuables gardiens des villages, des cols, des sommets. Alors, Louise, avertie, respectait leurs rites.
Dans ces maisons, la grande pièce servait à l’habitation. partout le même agencement fait de cuvettes, de marmites, d’un brasero et d’une provision de bois. Un liquide laiteux stagnait toujours dans une rigole de la petite cour intérieure, éclairée et aérée par une ouverture aménagée au-dessus d’un bassin qui recueillait les eaux de pluie.
Louise frictionnait ses mains avec de l’alcool et commençait ses soins. Ses malades étaient des vieux qui ne voulaient pas quitter leur couche de peur de contrarier les esprits. Ils restaient immobiles, marmonnant des paroles incompréhensibles. Il y avait le plus souvent des enfants qu’une mauvaise fièvre agitait. C’étaient des cris perçants à l’approche de Louise qui devait faire une piqûre ou nettoyer une plaie. Certaines mères arrivaient aux dernières semaines de leur grossesse. Louise tâtait leur ventre rond au nombril dilaté. Quelquefois prise de pitié, elle allongeait ces femmes épuisées par de nombreuses maternités et lavait doucement leur entrejambe. Les dernières recommandations étaient traduites par le mokhazni resté derrière la porte.
En général, les épouses françaises, selon l’affectation des maris, se devaient d’être pourvues d’un savoir-faire quasi professionnel ou capable de se rendre socialement utiles. S’il était vrai qu’aucune d’entre elles n’étaient oisives, la femme du capitaine était précieuse à tous et le médecin commandant ne la ménageait pas. Il lui donnait la liste des indigènes à soigner ou l’emmenait dans sa voiture faire la tournée des malades les plus éloignés. Il comptait sur elle pour mettre en place le dépistage des maladies infectieuses, pour organiser une vaccination généralisée. Les caïds étaient obligatoirement de la partie; devant une cohorte de Berbères, ils offraient leur bras dénudé pour montrer l’exemple.
Quelque fois Louise rentrait découragée; elle était la seule française à des kilomètres à la ronde. Le fort était une caserne abritant bon nombre de soldats et d’officiers; certains d’entre eux étaient mariés et pères de famille. Leurs épouse et enfants, qu’ils allaient voir le temps d’une permission, habitaient Marrakech. Ces moments, Louise les avait connus; aujourd’hui elle était loin de la banalité des brillantes soirées des cercles militaires. Sa vie avait tellement changé, affirmant même l’extrême densité d’une existence.
L’école dans tout le Haut Atlas n’existait pas. Il fallait l’inventer pour sa fille en âge d’apprendre. Louise eut l’idée d’y associer les enfants des mokhaznis. Elle ne réussit pas à convaincre ces derniers; ils aimaient mieux voir leurs aînés fréquenter la mosquée pour y apprendre le Coran. Ces hommes du Makhzen étaient des hommes dévoués à la France, conscients de leur mission, mais les troubles passés les avaient fait réfléchir, peut-être alarmés. Aussi choisissaient-ils d’être seuls responsables d’une situation qui pouvait être un jour aussi bien favorable que désavantageuse. Leur famille appartenait à un clan et ils la laissaient dans ce clan qui était leur protection.
Avec fierté et aidée par des cours par correspondance, Louise trouva le temps d’enseigner, quand elle n’était pas remplacée par henri, les éléments du calcul, de l’écriture et de vocabulaire à sa fille et aux enfants du cuisinier. Ces élèves assidus l’écoutaient attentivement et elle était amusée de les entendre scander les lettres et les chiffres comme s’ils s’agissait des versets du Coran. De sa voix aiguë, Claire les imitait en balançant son corps gracile d’avant en arrière.
Ainsi leur fille grandissait au milieu de ces enfants berbères. L’imprégnation du mode de vie local était si profonde chez elle qu’elle allait jusqu’à prendre une identité d’apparence. Elle portait en hiver un burnous de laine et avait comme unique signe de reconnaissance, des bottines de cuir rouge faites à ses mesures par les cordonniers de Marrakech. Lors des fêtes, et elles étaient nombreuses et réjouissantes, Latifa, épouse du cuisinier, l’habillait d’un caftan, la fardait et teintait de henné ses petites mains. Puis l’enfant se mêlait aux filles des tribus et dansait maladroitement avec elles au son des tambourins. Quelquefois elle partait avec Latifa et son mari; ceux-ci étaient fier et heureux de l’emmener dans leur famille. Elle en revenait plus perfectionnée en berbère mais pleine de poux qui étaient des parasites bien familiers à tous.
Louise et henri vivaient sans appréhension; ils étaient conscients de la richesse qu’apportait à leur fille une autre civilisation. Puis ces contacts intimes entre deux communautés se faisaient naturellement, les enfants sachant nouer des liens en toute innocence.
Ainsi était la vie de la famille du couple quand elle n’était pas dérangée par des hôtes de passage. Quelquefois un coup de téléphone de Marrakech suffisait à troubler sa tranquillité. Des Français arrivaient de la Métropole, de tout milieu, de toute formation, avec un très grand désir d’entreprendre. Ils étaient surtout intéressés par les possibilités minières d’Imini, de Tiouine ou de Bou Azzer dont les gisements de manganèse, de cobalt et d’amiante étaient prometteurs.
Bien que sachant ces invités de la Résidence être des spéculateurs, Louise les recevaient avec déférence bien que ces hôtes s’étonnant d’un rien, critiquaient la vie féodale des indigènes et leur manque d’hygiène, sachant bien que les femmes qui les servaient, ne les comprenaient pas. Quand ils parlaient de développer le Maroc, on les sentait déjà en marge des lois ordinaires. Sans montrer son agacement, le capitaine des A.I., qui avait une responsabilité morale, jetait d’une voie nette et franche : “Il faut laisser ces indigènes, comme vous dites, dans leur cadre et les aider à prendre en main leur destin.” Ces propos subtilement politiques n’engageaient aucune discussion. Ils tombaient plutôt dans une totale indifférence. A la tête de capitaux privés, ces convives n’étaient attirés que par une fiscalité légère et discrète, une spéculation encouragée; le sort des populations ne les intéressait pas...
L'analyse politique de Gisèle Nesmon sur l'époque
“L’Istiqlal, parti nationaliste, avait engagé une épreuve de force avec la Résidence qui lui opposait un silence dédaigneux. Peut-être se rendait-elle compte que ses progrès dans le pays n’altéraient en rien la volonté d’indépendance de ces jeunes lettrés, fils de famille formés dans les universités françaises. Dans leurs discours, rédigés sur un ton nuancé et modéré, ils ne mettaient pas en cause le principe du Protectorat. Ils réclamaient la suppression de tous les aspects de l’administration directe. En somme, ils souhaitaient participer à l’exercice du pouvoir. Ils le firent savoir au cours de réunions organisées à travers le pays.
“De nombreux facteurs les y encourageaient. L’urbanisme progressait, le développement des communications favorisait le brassage des populations, la langue arabe gagnait du terrain car peu de Marocains étaient scolarisés dans les écoles françaises, ne le désirant pas eux-mêmes. Cette conjonction contribua à conforter l’esprit nationaliste. Cependant la totalité des habitants ne fut pas touchée par l’élargissement de ces audiences. Seule la petite bourgeoisie urbaine était affectée. Il fallut le détournement des eaux au profit des colons pour mettre le feu aux poudres. Des troubles éclatèrent principalement à Fès, à Meknès et l’intervention des forces de l’ordre fut brutale.
“L’emploi systématique des supplétifs marocains au sein de l’armée française donna aux combats un caractère fratricide. Les meetings, les associations, les journaux de langue arabe furent interdits, les dirigeants arrêtés. Les uns furent déportés au Gabon, les autres mis en résidence surveillée au Sahara. Le mouvement nationaliste était décapité. Cependant cette dissolution n’interrompit pas la réclamation des réformes, toujours dans le cadre du Protectorat. Ces dites réformes étaient conçues comme un moyen d’amener les Marocains à prendre progressivement la destinée de leur pays et de préparer l’avènement de l’indépendance. Cette opposition-là prit un caractère religieux et les mosquées devinrent le point de départ de toute manifestation. D’aucuns n’avaient oublié qu’il y avait un Roi. La fête du Trône fut institutionnalisée chaque 18 novembre. Elle visait à démentir les allégations des autorités du Protectorat tendant à montrer les Nationalistes hostiles au Sultan. Des cris “Yahia el Malik” (Vive le Roi) retentirent à travers le pays et le Roi laissa son peuple venir jusqu’à lui. Pour le moment, il était prisonnier de la Résidence. Condamné au silence, il ne connaissait ni l’étendue ni les limites de son pouvoir. Il devint alors une autorité morale.
“Malgré cette agitation qui était un appel à l’émancipation, à l’espérance et au renouveau, la Résidence continuait à traiter le peuple marocain comme s’il devait être perpétuellement dépendant. Elle s’appuya sur les Caïds. Elle comptait sur leur influence et leur fidélité, consacrant avec complaisance un régime féodal, anachronique au sein d’une démocratie. Ces “Chefs indigènes” étaient de riches propriétaires. Certains allaient jusqu’à posséder plus de 15000 hectares de terre et la moitié des Droits d’eau. Ils avaient encore de nombreux titres dans les affaires minières du pays. Alors ils voyaient d’un mauvais œil la disparition de leurs pouvoirs tant administratifs que judiciaires, bien que ceux-ci fussent sous l’étroit contrôle des officiers des Affaires Indigènes.
“Cependant la Seconde Guerre commençait à brûler l’Europe toute entière et il y eut, entre la Résidence et le peuple, un temps de rémission. Un calme relatif s’établit dans le pays à la demande du Roi. Il avait suffi que Celui-ci prononçât, au nom du Prophète, cette simple phrase : “Dieu ne bénit pas les coups portés à un homme accablé par l’adversité.
“Ce fut dans ce climat-là que vécut Henri X..., devenu capitaine et muté depuis son mariage à Ouarzazate. Face à ces événements, il resta lucide. Il analysa la situation et en mesura les réalités. Il lui sembla que le mouvement nationaliste avait une authentique révolte. Il ne faisait que subir l’influence des courants d’indépendance et de rénovation qui travaillaient profondément les pays arabes au lendemain de la Grande Guerre. Cependant il n’admettait pas ces gestes meurtriers; bombes artisanales éclatant dans les villes souvent mises à sac, massacres de colons dans le bled...
”Quand on prenait les armes au nom de la justice, ne faisait-on pas un pas de plus vers l’injustice ? Le processus était inversé et cela lui parut ironique, tragique. Henri jugeait le monde actuel sans la moindre allusion tant il lui apparaissait comme un tissu de mensonges et de lâchetés. Il songea que la liberté du peuple marocain et la monarchie ne faisaient qu’un. Ce sentiment diffus devenait tout à coup une réalité tangible. Arrivé au bout de sa pensée, il en conclut que le Maroc deviendrait une nation.”
Aujourd'hui, quel jugement porte-t-on sur eux ?
Tant d’année après, si on pense encore aux officiers des A.I., quel jugement porte-t-on sur eux ?
Un ingénieur des mines, très éloigné du monde de l’armée, donne son opinion :
“Les officiers des A.I. avaient en principe dans le Sud les mêmes fonctions que les contrôleurs civils en zone urbaine; en fait, leur pouvoir était plus étendu et ils l’exerçaient avec un incontestable panache. Ils étaient comme on disait, les derniers seigneurs... Très respectés des caïds et de leurs sujets, ils pouvaient tout demander; n’hésitant pas à faire appel aux corvées, ils construisaient des routes, des ouvrages d’irrigation, rendaient la justice. Leurs épouses ouvraient dispensaires et écoles. Ce n’est pas seulement une image d’Epinal : pour eux, défendre les indigènes et les servir était une vocation. Leur carrière en pâtissait; mais ils préféraient cette vie aux intrigues d’état-major. Je dois dire que moi, qui était plutôt antimilitariste, j’ai souvent été très impressionné par leur qualité d’hommes”.
Roger Naudet
Au début de 1989, S.M. le roi Hassan II, dans une interview accordée au Nouvel Observateur, s’est exprimé ainsi :
“C’est là qu’intervient une sorte nostalgie. Oui !, je vais vous surprendre, j’en arrive dans ces moments-là, tenez-vous bien, à regretter ces contrôleurs civils et ses officiers des Affaires Indigènes qui, sous le régime honni de la colonisation, n’en avaient pas moins une connaissance intime de l’âme marocaine et de l’islamisme qui l’irrigue. Ce n’est pas de leur côté qu’on aurait trouvé des hommes pour sous-estimer la dimension spirituelle et collective d’un élan qui, ailleurs, a débouché sur la construction de vos cathédrales.”
Le roi répondait à des critiques de J. Daniel à propos de la construction de la grande mosquée de Casablanc